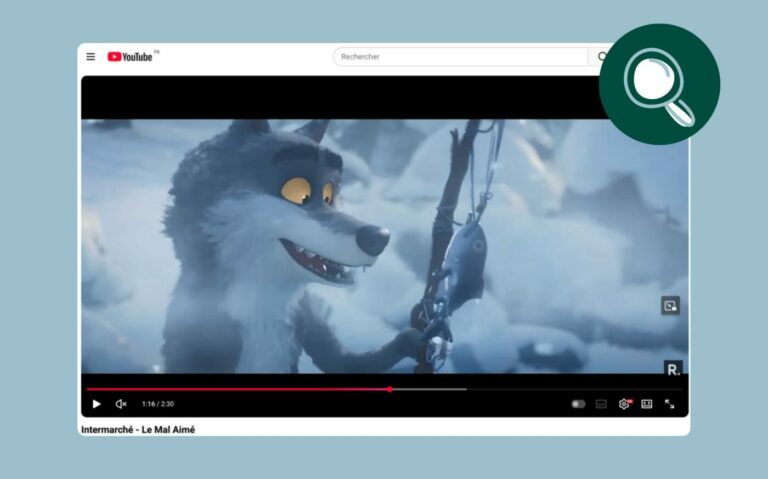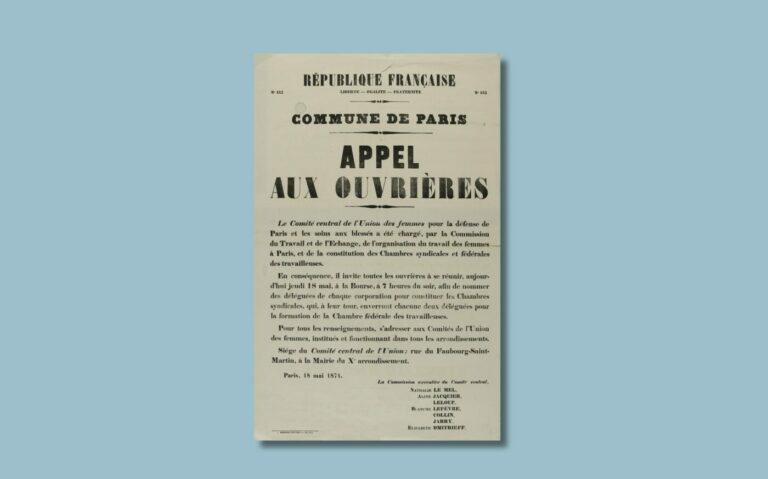Pour que chacun des humains puisse manger à sa faim, les Etats et collectivités doivent définir de véritables politiques alimentaires, qui soient en lien avec leurs politiques agricoles, de l’environnement et de santé. Olivier de Schutter fait le bilan de six années de mandat à l’Onu en tant que rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation, lors d’une conférence publique tenue à la Sorbonne à Paris, le 17 février. Pour lui, la fin de la faim ne pourra advenir que si les plus pauvres disposent d’une vraie protection sociale.
Bio Consom’acteurs: Selon la FAO (organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), plus d’un milliard de personnes souffrent de la faim dans le monde. Comment cette faim se traduit-elle?
Olivier De Schutter : La plus grande partie des personnes souffrant de la faim souffrent en fait de malnutrition, c’est-à-dire de carences, en particulier en micronutriments, tels que les vitamines, des éléments comme le fer, le potassium ou encore le zinc. Ces personnes carencées sont pauvres et c’est leur pauvreté qui est à l’origine de la faim. A noter que l’on observe aussi une nouvelle malnutrition se développer, cette fois dans les pays occidentaux. Il s’agit des personnes consommant trop de graisses saturées, de sel, de sucre, par rapport à leurs besoins. Cette malnutrition conduit à des problèmes de santé qu’on voit augmenter, comme l’obésité, certains cancers, certaines maladies cardio-vasculaires… Aux Etats-Unis et au Mexique par exemple, 30% des gens sont obèses.
Qui sont ces gens qui ont faim ?
Pour la majorité d’entre eux (50%), ce sont des petits producteurs, qui cultivent 1 à 2 hectares pour leur subsistance et qui, dans les périodes creuses sans récolte, sont obligés d’acheter les aliments le double du prix auquel ils avaient cultivé. Cette précarité finit par les amener à vendre leur force de travail sur de grandes plantations, ou à migrer vers les villes. A côté, il y a les paysans sans terre, qui représentent 20% des gens qui ont faim. Eux travaillent sur de grandes plantations, sans garantie de salaires minimum, sans pouvoir se plaindre et sans protection sociale. Et sont donc extrêmement vulnérables. 10% des gens qui ont faim sont des pêcheurs, cueilleurs ou éleveurs traditionnels – via le pastoralisme, qui dépendent de l’accès aux ressources naturelles. Et les 20% restants sont des urbains pauvres.
Ne suffirait-il pas de produire davantage d’aliments ?
Non, car la faim ne résulte pas de quantités de denrées insuffisantes, mais de politiques déficientes. Le point commun entre toutes les personnes qui ont faim, c’est qu’elles sont toutes victimes d’une certaine manière de concevoir les politiques agricoles : celles-ci investissent l’essentiel des efforts dans l’agriculture d’export, pour satisfaire la soif des marchés internationaux. A cause d’elles, les paysans finissent par migrer vers les villes ou devenir ouvriers agricoles. C’est la mécanique de la faim.
Comment enrayer cette mécanique de la faim ?
Il faudrait transformer la question de la faim, vue comme technique, à confier aux agronomes, ingénieurs, chercheurs et agriculteurs, en question politique. A confier à des Etats ou des entités plus petites (collectivités, territoires, etc.). Les politiques agricoles doivent se doubler de politiques alimentaires, qui ne s’intéressent plus seulement à l’aspect production agricole, mais aussi aux aspects sociaux, sanitaires. Ces politiques doivent évidemment être en lien avec les politiques de l’environnement. Car il faut se rendre à l’évidence : jusqu’à présent, les politiques agricoles ont eu du succès en termes de volumes, de rendements et d’accès au marché. Mais elles ont échoué pour nourrir le monde, travailler sur notre rapport à la nourriture et rester en-deçà des limites écologiques. Elles se sont trop concentrées sur l’aspect production, sans se préoccuper de la demande du consommateur, ni du rapport de celui-ci à la nourriture, qui est aujourd’hui indifférent.
En quoi notre demande et notre rapport à la nourriture sont-ils importants ?
D’abord parce qu’on voit les régimes alimentaires du monde évoluer rapidement et que ça commence à poser problème. Un exemple, la consommation de viande. Celle-ci augmente à mesure que croît le niveau de revenu moyen. Or elle détourne des calories végétales qui pourraient nourrir directement des humains : il faut entre cinq et douze calories de céréales pour produire une seule calorie animale. C’est dire si la viande est une utilisation très inefficiente des ressources à notre disposition ! Or, aujourd’hui, 80% du soja et 40% du maïs cultivé sont destinés à nourrir les animaux d’élevage. Les Etatsuniens et Australiens mangent 120 kg de viande par personne et par an, les Européens 80-85 kg, et les pays en développement nous emboîtent le pas : les Indiens et l’Afrique subsaharienne en sont à 11 kg, les Chinois à 62 kg. Or, pour que notre consommation de viande soit durable, il faudrait que les habitants de la planète se contentent de 35 kg/personne/an… Autre aspect de la demande sur lequel les politiques doivent travailler: le gaspillage alimentaire. Dans les pays riches, la moitié de celui-ci a lieu chez les ménages, c’est-à-dire chez vous et moi. Dans les pays pauvres, c’est au niveau du champ, par manque d’organisation des filières, du transport ou du stockage. Enfin, les régimes alimentaires tendent de plus en plus vers une nourriture industrialisée, transformée, empaquetée, dont l’origine et les ingrédients sont inconnus du consommateur. Résultat : beaucoup de calories gaspillées soit chez les ménages, soit au champ, soit via la consommation de viande, avec des répercussions sur la santé. Sans parler des limites écologiques que nous avons déjà franchies ou sommes en train de franchir.
Quelles sont ces limites écologiques ?
1) La biodiversité disparaît à un rythme dix fois plus important que le rythme de renouvellement normal des espèces. Pourquoi ? Notamment parce que la recherche agronomique s’est focalisée sur quelques espèces et races, au lieu de s’intéresser à la biodiversité dans son ensemble.
2) La consommation d’azote atmosphérique pour fabriquer des engrais. Nous en retirons 121 millions de tonnes par an, alors qu’il faudrait se contenter de 35 millions de tonnes par an pour une utilisation soutenable.
3) Les limites d’émissions de gaz à effet de serre pour ne pas contribuer à un changement climatique. C’est très problématique pour nos systèmes agricoles et alimentaires, qui sont à la fois une cause importante du changement climatique, et qui vont en pâtir. Le groupement intergouvernemental d’experts sur le climat (Giec) estime qu’un réchauffement de 4,5 à 4,8 degrés aura lieu d’ici la fin du siècle si aucune politique ambitieuse n’est mise en œuvre. Cela aura des répercussions sur l’agriculture : le Giec prévoit des chutes de productivité de -50% dans les régions tropicales, et de 6 à 8% à l’échelle mondiale! Ce, alors même que la population aura augmenté d’un tiers. Je précise que depuis l’invention de l’agriculture il y a environ 11 000 ans, la température moyenne sur le globe a varié dans un intervalle de 1°C seulement. Les plantes sont donc parfaitement adaptées aux climats actuels. Changez de température moyenne en quelques années : les plantes ne seront plus adaptées. Au final l’agriculture dans son ensemble est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Or, l’évolution de nos régimes alimentaires accélère cela. Ceux-ci s’homogénéisent de plus en plus vers de la nourriture industrialisée, transformée, empaquetée, venant de loin. Ce qui questionne encore une fois nos habitudes alimentaires, les cuisines du monde.
Et nous sommes en train de franchir d’autres limites …
Oui. A commencer par les conséquences de l’utilisation massive d’engrais à base d’azote et de phosphore. A force d’épandre de l’azote dans les champs, celui-ci s’écoule dans l’eau, favorisant le développement de zones mortes dans la mer où seules des algues vertes subsistent. C’est ce qui se passe dans le golfe du Mexique. Quant au phosphore, son pic de production est sans doute dépassé. Autre limite : l’eau. Aujourd’hui 70% de l’eau douce consommée par l’humain va dans les champs. En Inde et en Chine, on la puise de plus en plus profondément dans la terre, touchant des nappes d’eau fossile qui se renouvellent extrêmement lentement. Ce n’est pas durable. Et le nombre de régions affectées par le stress hydrique ne pourra qu’augmenter dans les années qui viennent. Dernière limite écologique que nous franchissons : le pic pétrolier. Nos systèmes alimentaires sont extrêmement énergivores, entre synthèse et transport de l’azote et des intrants, mécanisation au champ, transport des récoltes vers les lieux de transformation puis vers les lieux de distribution, empaquetage, stockage au froid… On observe une corrélation nette entre le prix du baril de pétrole et les prix alimentaires. La volatilité de ces derniers est une vraie source de préoccupation.
Quelles sont vos pistes de réflexion pour que le droit à l’alimentation soit respecté?
Les Etats doivent promouvoir l’agroécologie, qui est l’agriculture de la connaissance. Contrairement à l’agriculture industrielle, qui est linéaire dans la mesure où elle prélève, transforme, puis rejette des déchets, l’agroécologie a une approche cyclique, une vision globale de l’écosystème. Les déchets sont ainsi réintégrés dans les cycles naturels. Un agriculteur japonais, par exemple, a introduit des canards et des poissons dans sa rizière. Les animaux ont fertilisé le sol avec leurs déjections et aéré l’eau en circulant, les canards ont mangé les insectes… et la rizière a augmenté son rendement de 20%, tout en diminuant ses coûts d’exploitation de 80% ! Il y a bien d’autres techniques, comme le push pull très utilisé en Afrique de l’Est, ou l’agroforesterie.
Deuxième piste : relocaliser les systèmes agroalimentaires, puisque la faim prend sa source dans l’attention exclusivement portée à l’exportation et à l’accès aux grandes filières du marché international. De telles initiatives existent, au Brésil par exemple. Troisième piste : substituer la protection sociale à la poursuite d’une économie alimentaire low cost. Il faut que les plus pauvres disposent d’une protection sociale, ce qui n’est pas le cas de 80% des familles dans le monde. Les bas prix de l’alimentation ne sont qu’un substitut de protection sociale. Il faut au contraire donner une voix aux plus pauvres, et cesser de nourrir les gens avec une nourriture qui a des impacts sur la santé, l’environnement et la justice sociale.