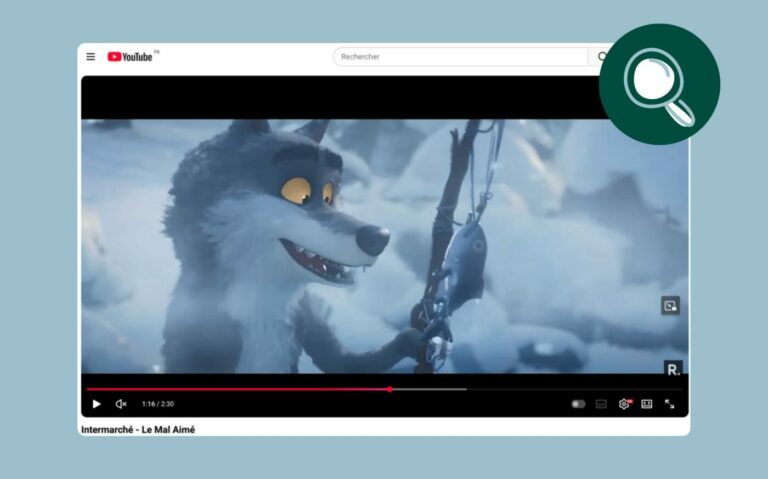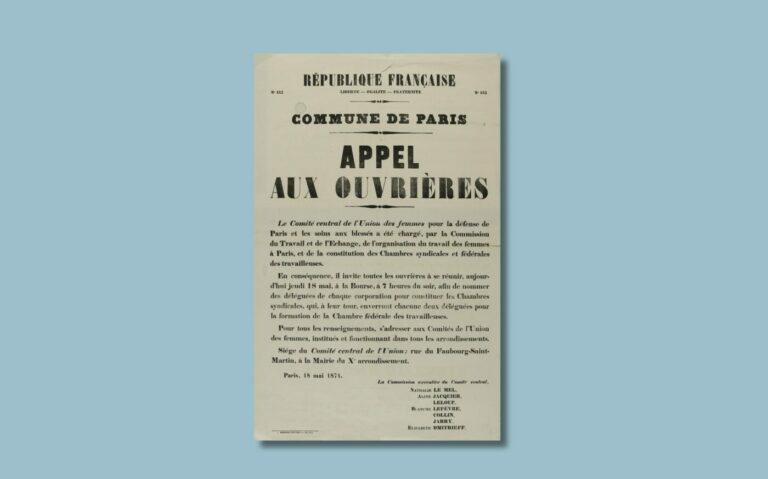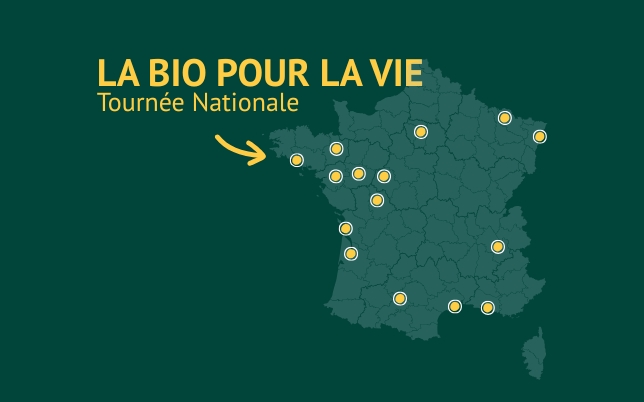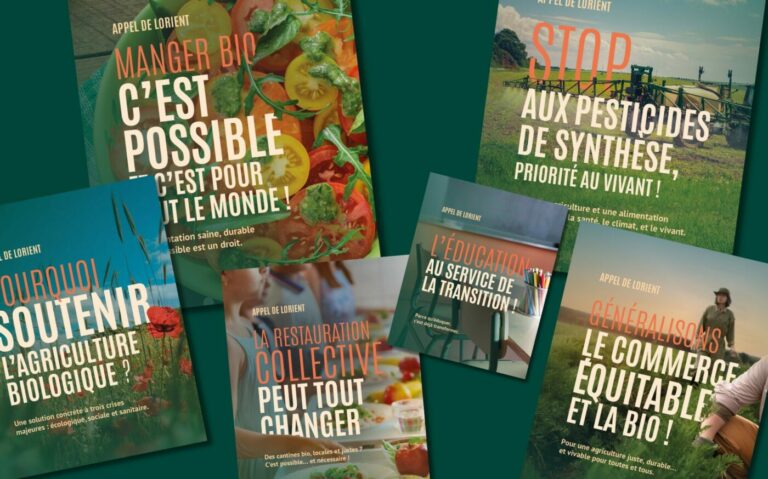La faim justifie-t-elle les moyens ?
La série d’articles qui va suivre porte sur les étudiant·es en situation de précarité alimentaire et est issue d’un mémoire rédigé en 2023 dans le cadre de mon Master de Sciences Politiques intitulé Les étudiant·es bénéficiaires d’aide alimentaire : la faim justifie-t-elle les moyens ?
Pour le premier volet de cette série, je souhaitais rendre compte de la genèse de ce projet de recherche et du cadre juridique dans lequel s’inscrit la précarité alimentaire en France, afin de permettre à nos lecteur·rices de comprendre l’origine de cette réflexion ainsi que les bornes législatives qui la caractérisent.
Genèse de la recherche
L’objet de recherche de ce mémoire portant sur les étudiant·es en situation de précarité alimentaire est issu d’un parcours personnel et professionnel marqué par des expériences significatives. Mon intérêt pour la cuisine, qui m’a conduit à exercer la profession de cuisinier pendant une année, a façonné mon appétence pour les diverses dimensions sociologiques liées à l’alimentation. La nourriture et sa consommation ne se limitent pas à une simple satisfaction de besoins physiologiques, mais revêtent aussi une dimension culturelle, symbolique et sociale complexe.
Ma propre expérience a également joué un rôle important dans le choix du sujet. En effet, en quittant le domicile familial il y a quelques années, j’ai parfois été confronté à une forme de précarité alimentaire en tant qu’étudiant. J’ai donc personnellement constaté en quoi nos modes de consommation alimentaire, et la privation qui peut résulter d’une d’insécurité alimentaire, impactent notre vie sociale, notre santé physique et mentale. De manière plus formelle, je dirais que le véritable déclencheur de cette recherche a été le premier confinement qui fut instauré en France lors de la pandémie de COVID-19 en 2020. J’ai été frappé à l’époque par les images diffusées par beaucoup de médias qui montraient d’interminables files d’attente de personnes recourant aux aides alimentaires, notamment de très nombreux étudiant·es. Je me suis alors demandé si cette situation, sans doute amplifiée par une crise sanitaire inédite, constituait vraiment un phénomène social si récent et jusqu’à quel point il avait été exacerbé par les circonstances liées au COVID-19.
J’ai par conséquent décidé de focaliser ma recherche sur les étudiant·es bénéficiaires d’aides alimentaires, faisant d’elles et d’eux mon principal groupe d’étude. D’autres facteurs sont venus s’ajouter aux précédents et m’ont conforté dans ce choix. Premièrement, les étudiant·es se démarquent sociologiquement du reste de la population bénéficiaire d’aides alimentaire par leur statut social particulier. Ils et elles sont par définition, engagés dans des études post-bac, ce qui en fait un échantillon de population particulier par rapport au reste des bénéficiaires ; leur situation de précarité semble circonstancielle et temporaire en comparaison à d’autres groupes éprouvant des formes de précarités moins conjoncturelles ; ils et elles bénéficient des aides alimentaires sur une période réduite, intimement liée à leurs années d’études d’après les témoignages recueillis (mais également selon les études sociologiques qu’il m’a été donné de consulter et que je détaillerai dans la suite de la série). Cependant, il existe, au sein de cet échantillon de la population des bénéficiaires, des disparités sociales particulières qui bousculent l’homogénéité supposée de ce sous-groupe. Par exemple, si le recours aux aides alimentaires s’explique d’abord par les difficultés économiques que les étudiant·es traversent au cours de leurs de leurs années d’étude, il n’en demeure pas moins que tous et toutes invoquent par la suite des raisons différentes pour se rendre aux distributions d’aides alimentaires. De la même manière, les conséquences de cette forme de protection sociale sur leurs habitudes alimentaires, leurs choix de courses et leurs vies sociales sont loin d’être uniformes. Il m’est alors apparu que les étudiant·es n’appréhendent ni ne tirent avantage de l’aide alimentaire de la même façon. Leurs origines sociales, genres et nationalités, leurs parcours éducatifs, leurs rapports à la protection sociale en général, jouent autant de rôles déterminants dans leurs expériences de l’aide alimentaire. Ces éléments influent sur leurs conduites et leurs positionnements envers les aides alimentaires, sur leurs interactions avec les structures de soutien et leur perception à recourir en toute légitimité à ce droit.
Le droit à l’alimentation : une promesse non tenue
Le constat que certaines personnes, notamment les étudiant·es, doivent dépendre directement de l’aide alimentaire, en faisant la queue parfois deux heures pour obtenir ces ressources, est le signe que l’accès à l’alimentation n’est pas pleinement assuré par l’État, en dépit de ses engagements1
Pour se conformer aux politiques publiques de l’alimentation, l’aide alimentaire est encadrée juridiquement par le droit français depuis la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010. Ce texte propose de définir l’aide alimentaire comme « ayant pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies. Cette aide est apportée tant par l’Union européenne que par l’Etat ou toute autre personne morale ». Ainsi, l’aide alimentaire est envisagée à l’échelle européenne dans le cadre de la stratégie Europe 2020 dont l’objectif est de réduire d’au-moins 20 millions le nombre de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion sociale. En France, le budget alloué aux aides alimentaires a été estimée en 2009 par la Cour des comptes à plus d’un milliard d’euros par an2. Ce financement se divise en trois parts : un quart d’aides publiques (aide européenne, dépenses budgétaires de l’Etat et des collectivités territoriales, exonérations fiscales), un quart d’aides privées (dont en nature et en espèce, mécénat, récupération des invendus, etc.), et la moitié correspondant à la valorisation du bénévolat au sein des associations intervenant dans le dispositif d’aide alimentaire.3
De la même façon que pour l’accès à l’emploi, aux soins de santé et à l’hébergement, le droit à une alimentation de qualité et en quantité suffisante pour tous et toutes demeure un objectif non atteint. Les bénéficiaires des aides alimentaires partagent une forme de vulnérabilité commune. Jusqu’alors, les actions des organisations de lutte contre la précarité alimentaire semblent amoindrir la violence alimentaire subie par un certain pan de la population en défendant un accès à l’alimentation, bien que le don de nourriture ne corresponde pas exactement à l’idée d’un « accès » tel qu’il est défini par la loi. C’est là qu’une violence systématique et structurelle est vécue à plusieurs niveaux, que ce soit par les structures de distributions alimentaires, par les bénévoles mais aussi et surtout par les bénéficiaires.
Dans le deuxième volet de cette série d’articles, nous tâcherons de décrire ces formes de violence du point de vue des personnes qui en sont victimes. Nous envisagerons alors une lecture de ce phénomène sous le prisme de la conformité à la justice et au droit. Cela permettra de décrire les effets physiques et moraux que provoque la violation du droit fondamental de l’accès à une alimentation de qualité et en quantité suffisante.
_____________________________________________
1Tels que stipulés dans l’article 25-1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et la loi n°2010-874 de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche, qui précise (dans son article L 230-1) : « la politique publique de l’alimentation vise à assurer à la population l’accès dans des conditions économiquement acceptables par tous, à une alimentation sûre, diversifiée en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, produite dans des conditions durables. Elle vise à offrir à chacun les conditions du choix de son alimentation en fonction de ses souhaits, de ses contraintes et de ses besoins nutritionnels, pour son bien-être et sa santé […]. »
2 Rapport de la Cour des Comptes sur les circuits et mécanismes financiers concourant à l’aide alimentaire en France, septembre 2009
3 « Evaluation ex ante du Programme Opérationnel 2014-2020 pour la mise en œuvre du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) ». Source : http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article439.