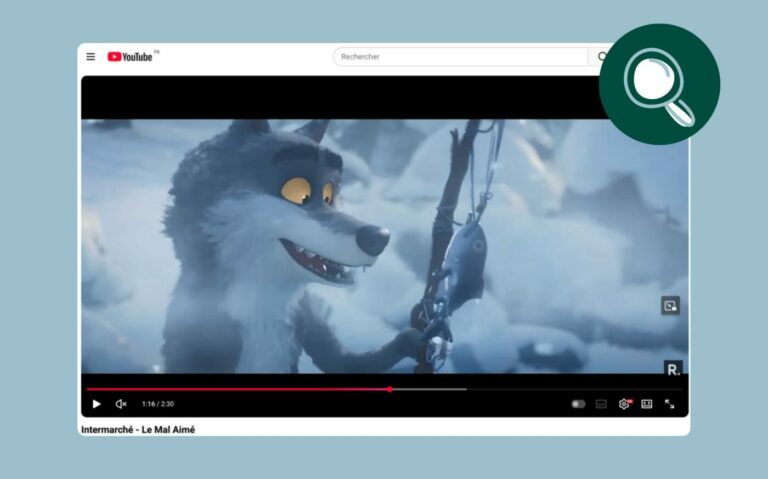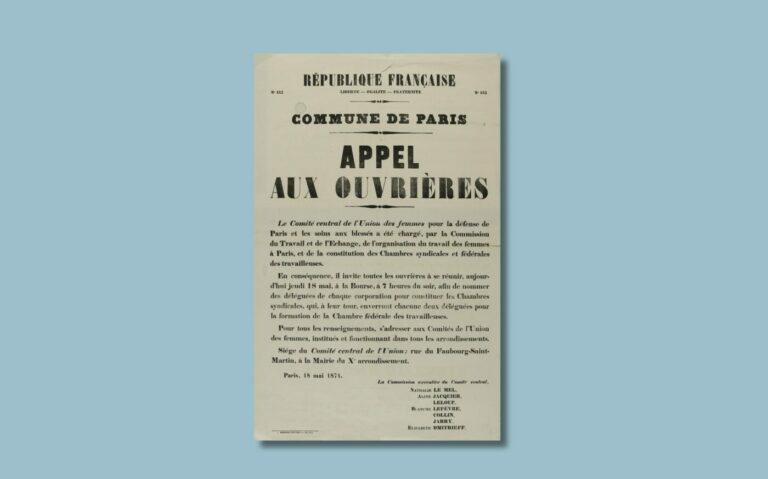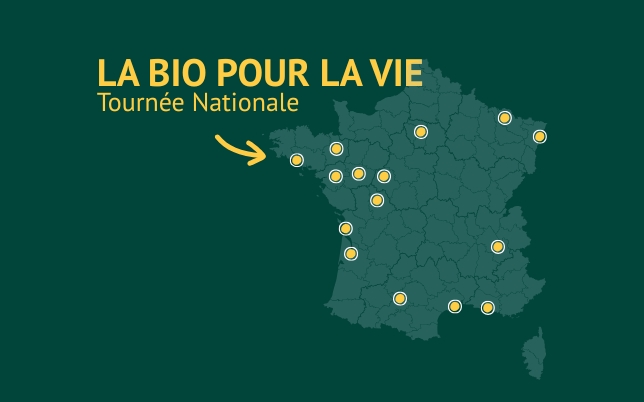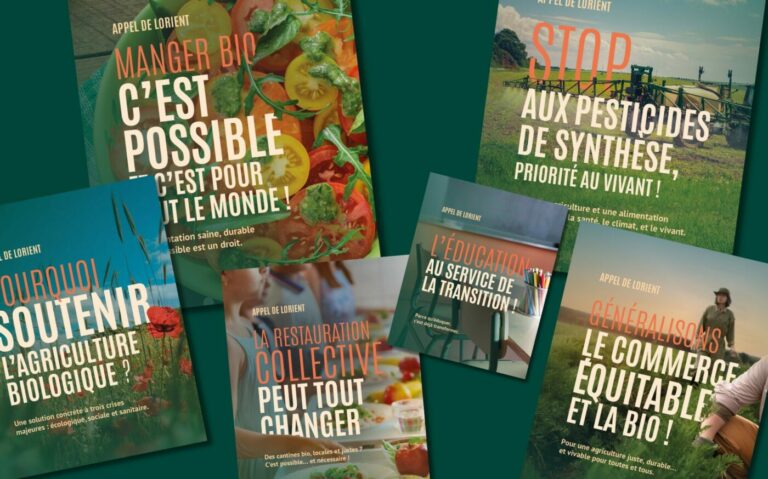La Bio au service de la santé
Un regard sur la maladie de Parkinson, les pesticides et l’agriculture de demain
La maladie de Parkinson est une maladie chronique neurodégénérative qui touche principalement les personnes de plus de 60 ans. Elle se caractérise par la disparition progressive des neurones dopaminergiques dans le cerveau, entraînant des troubles moteurs notables. Ainsi, lorsque 50 à 70 % de ces neurones sont détruits, les personnes concernées éprouvent des difficultés à initier un mouvement, un ralentissement des gestes, une écriture qui devient de plus en plus petite et difficile, une rigidité des membres ainsi que des tremblements au repos. On estime que cette maladie affecte entre 1 et 3 % de la population des seniors.
Les pesticides et la maladie de Parkinson : un lien préoccupant
Depuis 2012, la maladie de Parkinson peut, sous certaines conditions, être reconnue comme maladie professionnelle chez les agriculteurs (1). Cette reconnaissance repose notamment sur le constat suivant : l’exposition aux pesticides pourrait jouer un rôle dans le développement de cette pathologie. Plusieurs études ont en effet mis en évidence que certains pesticides endommageaient le système nerveux, augmentant le risque de développement de cette maladie (2, 3).
Une recherche réalisée aux Pays-Bas a évalué 153 pesticides et en a identifié 21 qui pourraient accroître le risque de développer la maladie (3). Les produits incriminés, principalement utilisés sur des cultures telles que les céréales et les pommes de terre, seraient potentiellement responsables d’effets neurotoxiques (3).
Des chiffres qui interpellent
Les données issues des recherches menées auprès des agriculteurs sont particulièrement préoccupantes : 1800 nouveaux cas par an se sont déclarés chez les exploitants agricoles âgés de 55 ans et plus et affiliés à la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Ces cas représentent une incidence 13 % plus haute que chez les personnes affiliées aux autres régimes d’assurance maladie. L’incidence de la maladie de Parkinson est encore plus élevée dans les cantons les plus agricoles, touchant même des personnes qui ne travaillent pas directement dans le secteur agricole (1).
Une étude cas-témoins comparant 133 agriculteurs atteints de Parkinson à 298 agriculteurs non-atteints a révélé que ceux affectés déclaraient avoir été plus fréquemment exposés aux pesticides. Les risques les plus marqués concernaient l’exposition professionnelle aux insecticides et aux fongicides, surtout chez les agriculteurs ayant une longue carrière dans l’utilisation de ces substances (4).
L’agriculture biologique : une alternative pour la santé
Face à ces constats, l’agriculture biologique apparaît comme une alternative incontournable pour réduire l’exposition aux pesticides et, par conséquent, les risques pour la santé. En privilégiant des méthodes qui n’emploient pas de produits chimiques de synthèse, le bio contribue à protéger non seulement les consommateurs, mais aussi les agriculteurs et l’environnement. Moins exposées aux substances potentiellement neurotoxiques, les personnes vivant et travaillant en milieu agricole bénéficient d’un cadre de vie plus sain.
Conclusion
Les liens entre l’utilisation des pesticides et la maladie de Parkinson ne sont plus à démontrer. Les études montrent clairement un risque accru chez les agriculteurs ainsi que dans les zones fortement agricoles. Dans ce contexte, promouvoir l’agriculture biologique relève non seulement d’un choix écologique, mais également d’un enjeu majeur de santé publique.
Références
(1) Les agriculteurs et la maladie de Parkinson. (2018), Santé publique France.
(2) Ball N. et al., Parkinson’s Disease and the Environment. Frontiers in Neurology (mars 2019). doi:10.3389/fneur.2019.00218
(3) Brouwer M. et al., Environmental exposure to pesticides and the risk of Parkinson’s disease in the Netherlands. Environment International, Volume 107 (octobre 2017), Pages 100-110, doi:10.1016/j.envint.2017.07.001
(4) Moisan F., Spinosi J., Delabre L., et al., Association of Parkinson’s Disease and Its Subtypes with Agricultural Pesticide Exposures in Men: A Case-Control Study in France. Environ Health Perspect. 2015;123(11):1123-1129. doi:10.1289/ehp.1307970