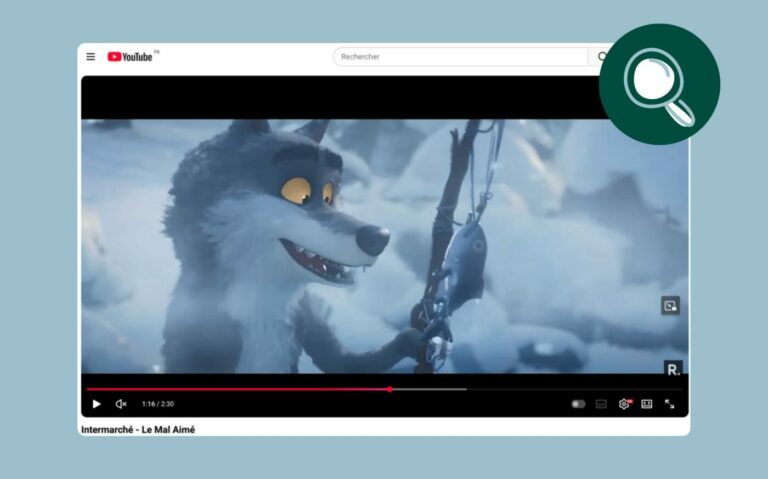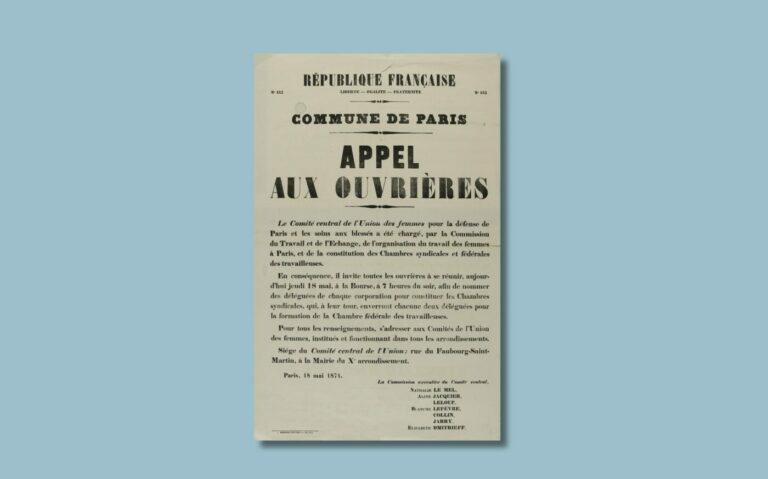Un colloque sur l’agroécologie s’est tenu au Sénat le 8 avril dernier. Réunissant acteurs de l’agriculture, élus, institutionnels et ingénieurs, cet événement organisé par Joël Labbé, sénateur du Morbihan, a permis de définir l’agroécologie et d’imaginer des solutions pour y engager la France.
«On ne va pas tout révolutionner mais enclencher un processus», c’est ainsi que le ministre français de l’agriculture Stéphane Le Foll a ouvert le colloque «l’agroécologie, une pratique d’avenir», qui s’est déroulé le 8 avril au palais du Luxembourg. Organisé par le sénateur Europe-écologie-les-verts Joël Labbé, l’événement a réuni élus, agriculteurs, acteurs de la bio, chercheurs et associations. Avec ses 3,8% de surface agricole utile en bio en 2011, « la France doit rattraper son retard», reconnaît Le Foll, pour être «leader de l’agroécologie», comme il l’avait avancé lors du colloque du 18 décembre 2012. Mais pourquoi l’agroécologie, au fait ?
* L’agroécologie, un enjeu de société
«Algues vertes, nitrates, pollution aux insecticides, au lisier et aux nitrates, pauvreté dans les pays du Sud, viande de cheval dans des plats au bœuf, émissions de gaz à effet de serre… Le passage à l’agroécologie est avant tout la réponse à une demande sociétale, pas un rêve de bobos en mal de nature !» affirme Marc Dufumier, ingénieur agronome à AgroParis Tech.
Agressive pour l’environnement, l’agriculture industrielle a aussi atteint ses limites en termes de productivité. «Depuis une quinzaine d’années, on observe une stagnation des rendements de céréales dans toute l’Europe», pointe Fabien Liagre du bureau d’étude sur l’agroforesterie Agroof. En cause : la baisse de la fertilité des sols, une diminution de la biodiversité et le changement climatique, qui fait notamment augmenter les températures printanières.
Enfin, notre modèle agricole industriel, basé sur les intrants, les machines et les monocultures, est cause de chômage. A cause de l’exode rural, «200 fermes disparaissent chaque semaine du territoire français», déplore Marie-Monique Robin, journaliste d’investigation qui animait le colloque et présentait, entre deux tables-rondes, des extraits de son documentaire, les moissons du futur. Pour limiter cette débandade, notre agriculture a intérêt à prendre un virage à 180 degrés.
* Une agriculture écologique, qu’est ce que c’est ?
L’agroécologie est la fusion de l’agronomie et de l’écologie. Elle applique les principes de l’écologie – c’est-à-dire l’étude des interactions entre les êtres vivants et leur milieu – à la conception et au maintien des agroécosystèmes, c’est-à-dire des milieux modifiés par l’homme pour faire de l’agriculture. Faire de l’agroécologie, c’est donc étudier non seulement les plantes cultivées, mais aussi les cycles de l’eau, de l’air, du sol, des champignons, des bactéries, des animaux, du carbone, des arbres, des humains, etc. L’agriculteur met en valeur les synergies, compétitions, associations, etc. entre ces éléments de l’écosystème, pour que son activité de producteur d’aliments soit efficace et durable. L’agroécologie est donc une science complexe, qui demande plus de main d’œuvre que l’agriculture conventionnelle et qui se base aussi sur les savoirs traditionnels.
Puisqu’elle dépend de l’écosystème où elle est pratiquée, l’agroécologie ne peut être que locale. Et donc se traduire par des pratiques variables selon les endroits. «L’agroécologie a horreur de l’uniformité», souligne François Léger, enseignant chercheur à AgroParis Tech. Elle doit être adaptée à un ensemble de conditions propres au territoire (climat, qualité du sol, relief, faune et flore, patrimoine paysager, culturel, etc.). C’est pour cela qu’elle ne peut se déployer que par des acteurs (institutionnels, citoyens, associations, agriculteurs…) ancrés dans le territoire et spécifiques à celui-ci. Olivier De Schutter appelle ainsi à des «réformes allant bien au-delà du ministère de l’agriculture, qui touchent aussi ceux de l’écologie et des finances notamment».
* Une agriculture qui favorise résilience et autonomie
Basée sur la biodiversité de l’écosystème (dont l’homme fait partie), l’agroécologie favorise la résilience de celui-ci, c’est-à-dire sa capacité à s’adapter aux perturbations. Et des perturbations, on en voit débouler en nombre: phénomènes météorologiques extrêmes dus au changement climatique, pic pétrolier, pénurie alimentaire, crises sanitaires et économiques, etc.
Qui dit résilience des écosystèmes dit autonomie des groupes humains. Les agriculteurs ne pourront vraiment favoriser la résilience de leurs champs – et plus loin, que lorsqu’ils ne dépendront plus des semenciers, du marché, des fabricants d’intrants, des filières agroalimentaires, etc. Cet autonomie conduit à l’autonomie alimentaire : le fait qu’un territoire puisse se nourrir avec ses propres produits de cultures. «Aujourd’hui, les villes ont au mieux 2 jours d’autonomie en nourriture», estime Marie-Monique Robin. Rétroactivement, la résilience d’un système favorise son autonomie. C’est un cercle vertueux.
Mais l’agroécologie perdra son sens si elle se limite à une niche, comme c’est le cas pour l’agriculture labellisée bio. L’agroécologie est l’agriculture de l’avenir, le cadre de référence général. «Il faut tout simplement réinventer tout le système alimentaire, de la production à la consommation», résume François Léger. C’est pourquoi la labellisation de l’agroécologie n’est pas souhaitable, avec tous les risque des récupération du concept (greenwashing) que celui-ci impliquerait.
* Informer les citoyens des externalités négatives de l’agriculture conventionnelle…
Contrairement à l’agriculture conventionnelle, l’agroécologie a pour but – outre produire des aliments- de limiter ses impacts négatifs sur l’environnement et la société. Des impacts que l’on paye via nos impôts. Invisibles sur l’étiquette d’un produit, ces coûts, dits externalités négatives, ont été calculés par Sylvain Ly et Christophe Alliot, fondateurs du bureau d’analyse Satori. Ils estiment que pour générer 1 euro de chiffre d’affaires, la filière lait française conventionnelle prélève 28 centimes à la société. En bio, elle ne prélève que 17 centimes. Et on ne lâche que 10 centimes lorsqu’il s’agit d’un produit à la fois bio et de montagne (donc artisanal). Payé par Bibi, cet argent se répartit notamment entre: émissions de gaz à effet de serre, pollutions de l’eau, émissions d’ammoniac toxique, importations de tourteaux de soja, consommations d’eau et d’intrants pour cultiver le maïs fourrage, consommation d’eau pour transformer le lait, emballage, coûts d’hospitalisation de bébés nourris au lait de vache, export de poudre de lait en Afrique, emplois agricoles précaires, et caetera. Conclusion: pour évaluer le coût de l’agriculture, il faut intégrer les coûts socio-environnementaux. Sinon, on paiera la facture après.
* …et rémunérer les externalités positives de l’agroécologie
Les produits bio sont aujourd’hui plus chers en magasin que les conventionnels. Et aujourd’hui, c’est l’agriculture biologique qui se rapproche le plus du concept de l’agroécologie, malgré un cahier des charges européen surtout limité au respect de critères techniques. Pour Marc Dufumier, ces produits pourraient être plus accessibles. A condition que l’Etat rémunère les agriculteurs pour les services qu’ils rendent à la société. «Je plante des haies ? Je suis rémunéré. Je fabrique de l’humus ? Je suis rémunéré. Je prends soin de l’état des eaux ? Je suis rémunéré, etc.». L’agroécologie étant une agriculture artisanale, savante et au service de l’intérêt général, ceux qui la pratiquent mériteraient d’être mieux rémunérés.
* Les citoyens ont leur rôle à jouer dans la transition
L’agriculture deviendra écologique en France que si nous revoyons notre mode d’alimentation. Traduction : il va falloir ralentir sérieusement sur les produits d’origine animale et passer plus de protéines végétales (pois, haricots, lentilles…) à la casserole. Actuellement, la France est «une machine à produire du lait et de la viande», annonce Philippe Pointereau, directeur du pôle écologie de l’entreprise Solagro. 84% de la surface agricole utile française sont destinées aux cultures pour ces deux types de produits (céréales et fourrage des animaux compris).
Autre moyen d’agir concrètement pour l’agroécologie : manger local. Parce que ça crée de l’emploi, et l’agriculture en manque. Selon le convertisseur alimentaire de Terre de liens Normandie, qui recueille l’épargne citoyenne pour aider l’installation d’agriculteurs, le simple fait que les 65 millions de Français mangent bio et local ferait travailler 1,2 million de paysans. Soit trois plus qu’aujourd’hui ! Contrairement à ce qu’on croit souvent, «la France ne nourrit pas le monde. C’est lui qui nous nourrit », fait remarquer Philippe Pointereau. Moindre disponibilité des terres agricoles (à cause de l’urbanisation), rendements qui stagnent : la production agricole par habitant diminue. Les Français doivent prendre conscience que ce pays est aujourd’hui «importateur net de terres agricoles». L’avenir est donc à la cuisine végétale goûteuse et locale. «Travaillons sur l’aspect gustatif, culinaire, qualitatif : apprenons à apprécier un bon camembert de temps en temps que des mauvais, tous les jours».
* Les obstacles à la transition
Face au besoin sociétal se dressent des murs propres à notre modèle agricole actuel. Olivier De Schutter, rapporteur spécial des nations unies pour l’alimentation, les récapitule:
– la marginalisation des petites exploitations familiales, pas assez intégrées dans les politiques publiques, bien que plus productives que les grandes exploitations de monocultures;
– les politiques agricoles basées sur la compétitivité aux exportations ;
– l’insuffisante promotion de la recherche en agroécologie. Un exemple : l’agroforesterie, c’est-à-dire la science de l’agriculture en interaction avec les arbres, n’est étudiée que par «une seule équipe à l’Inra, dont un seul chercheur à temps plein», regrette Fabien Liagre, responsable R&D au bureau d’étude Agroof. Qui ajoute que seulement 500 paysans travaillent en agroforesterie aujourd’hui.
– la croyance dans le fait que modernisation de l’agriculture rime avec industrialisation. Alors que l’agroécologie est une « agriculture de pointe, qui n’est pas une nostalgie de l’agriculture traditionnelle » ;
– la non intégration des externalités négatives dans le coût véritable de l’agriculture ;
– la menace d’une instrumentalisation du concept de l’agroécologie – c’est-à-dire du greenwashing. C’est le risque d’un label « agroécologie », qu’Olivier De Schutter ne juge pas nécessaire. Il souligne néanmoins qu’il faut donner les moyens au consom’acteur de choisir, «par exemple en mettant en place un indicateur des coûts socio-environnementaux [NDLR: comme celui du cabinet Satori]. Aujourd’hui le seul critère est le prix, ce qui nous conduit à une agriculture low cost, en perte de vitesse ».
– Enfin, Olivier De Schutter pointe du doigt la vision trop court-termiste des personnes politiques. Si tel n’était pas le cas, celles-ci se donneraient les moyens d’«aménager la transition d’agriculteurs conventionnels vers l’agroécologie en 5 ou 6 ans», estime-t-il. Il est également de la responsabilité des politiques de «créer un mécanisme financier de stabilisation des revenus à tous ceux qui veulent s’engager dans l’agroécologie».
Pour Jacques Caplat, agronome et géographe, la clef de la transition agroécologique est la reterritorialisation de l’économie. «Il faut arrêter d’agrandir les fermes, mais plutôt créer des connexions entre elles et avec les filières». A cette condition, la transition vers l’agroécologie pourrait donc être lancée, alternant selon lui entre continuité et ruptures. «Les agriculteurs conventionnels pourraient dans un premier temps substituer des intrants et des pratiques par d’autres plus naturels (huiles essentielles, haies, rotations, bandes enherbées…)». Mais des ruptures seront nécessaires. Elles amèneront d’abord à des agroécosystèmes «avec recours occasionnel à la chimie, puis à des agroécosystèmes cohérents».