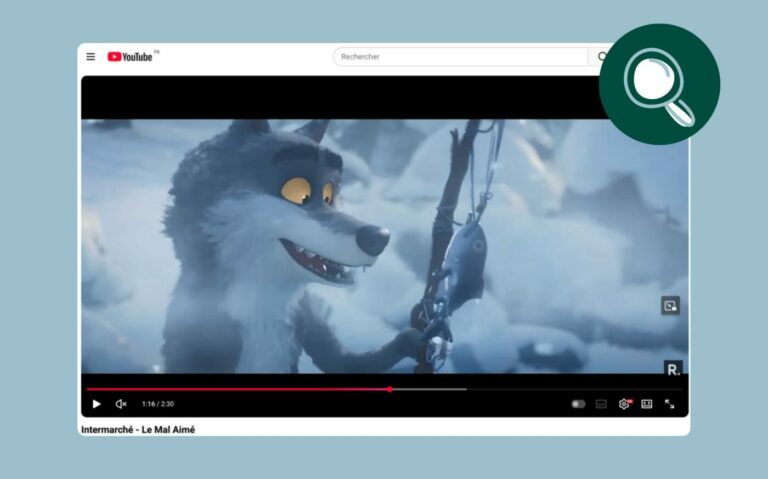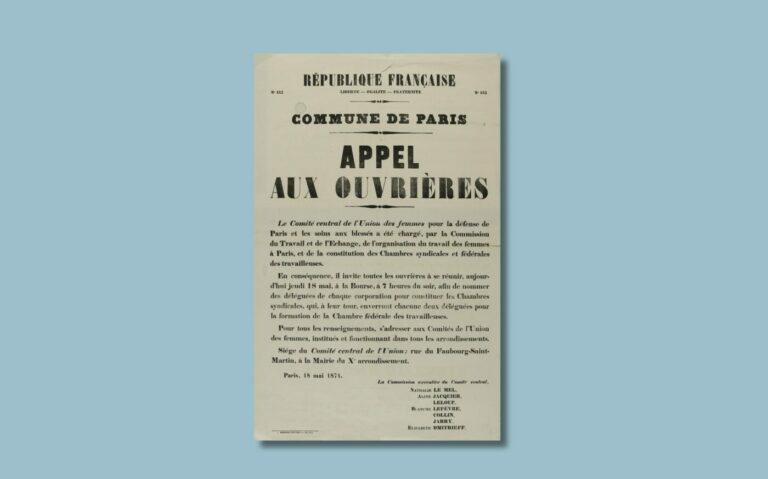Stéphanie Pageot est présidente de la Fédération nationale d’agriculture biologique. Membre du comité de soutien de Bio Consom’acteurs, elle répond aux questions que se posent de nombreuses personnes pas convaincues par la bio, notamment sur ses différences profondes avec l’agriculture conventionnelle, au-delà du cahier des charges bio européen. Interview.
En agriculture bio, on essaie de travailler avec la vie et non contre elle. Concrètement, que faites-vous pour les ravageurs et les maladies ?
Ce qu’il faut savoir avant tout, c’est que les maladies ou ravageurs présents dans les cultures ne sont que le résultat d’un déséquilibre du sol, des plantes ou du climat. Il faut donc absolument essayer d’établir un équilibre global sur nos fermes. Ce qui n’est pas simple, au regard des variations climatiques, de plus en plus intenses ces dernières années.
Bien sûr, il y a des ravageurs. Mais à vouloir les tuer à tout prix avec des pesticides, on finit toujours par perdre. Prenez le cas des insectes aux Etats-Unis (voir l‘article du Monde du 20 août dernier). Il y en a plein qui se sont adaptés aux insecticides chimiques de synthèse. Maintenant ils prolifèrent, au point d’inquiéter les autorités ! Les pesticides engendrent donc des insectes mutants dont on ne sait plus comment se débarrasser, et en plus, ils tuent les espèces qui ne nous gênent pas, voire qui nous aident, comme les oiseaux et les insectes pollinisateurs. C’est une fuite en avant.
En bio, nous privilégions les observations du monde végétal et animal, et essayons de nous appuyer sur les ressources que la nature nous offre. Et pour pouvoir produire des aliments de qualité, il faut qu’on s’adapte en permanence à ses aléas : par exemple savoir limiter la pression parasitaire, une espèce invasive, les variations du climat, etc. Pour cela, on utilise des semences adaptées à notre territoire, on stimule la vie microbienne du sol, on renforce l’immunité des cultures et des animaux avec des plantes, etc.Toutes ces pratiques et techniques sont retranscrites en partie dans le cahier des charges européens qui permet de donner un standard à toute la production bio européenne.
Ce qu’il faut remarquer, c’est qu’on sort ici des caricatures des débats pseudo-philosophiques et idéologiques sur la nature pire ennemi de l’homme, ou la nature intouchable. Travailler avec la nature, c’est la respecter au profit de la survie de l’espèce humaine.
Mais le cahier des charges bio déroule surtout une liste de techniques…
C’est vrai, mais le projet de la bio va bien au-delà. Il se veut avant tout progressiste, humaniste et solidaire. C’est d’ailleurs ce qu’on peut lire dans la charte d’IFOAM Monde [International foundation for organic agriculture, l’association internationale des acteurs de la bio, fondée par Nature & Progrès à Versailles en 1972], qui pose les bases de l’agriculture bio.
Le règlement bio européen est ce qu’il est. Mais la bio est en train de changer d’échelle en France. En tant qu’agriculteurs bio, nous nous apercevons que nous sommes au cœur des questionnements de notre société. C’est pour cela que le mouvement de la Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB), qui a été créé en 1978 par 4 paysans, a actualisé son positionnement dans une nouvelle charte qui réaffirme nos valeurs. Elle dit clairement que la bio dépasse les seules pratiques agricoles, et concerne aussi l’économie, les rapports sociaux dans la filière, les liens politiques entre ces innovations agricoles et le reste de la société. Cette charte donne une orientation claire du projet politique que nous portons.
Au-delà de l’absence d’utilisation d’intrants chimiques et d’OGM, quel est l’intérêt de la bio par rapport au conventionnel ?
La bio, c’est avant tout mettre l’humain au cœur de la production agricole.
Concrètement, la bio représente de la ressource humaine, dans une période marquée par le chômage de masse. Une récente étude du ministère (Agreste, juillet 2016) montre que la pratique de l’AB est plus créatrice d’emploi.
Ensuite, la bio permet de recréer de l’activité économique dans les territoires ruraux, grâce à des circuits de proximité innovants (amap, paniers, magasins de producteurs, etc.) et plus largement grâce à une approche circulaire de l’agriculture : par exemple, nous travaillons à la conversion en bio sur zone de captage d’eau, avec introduction des produits dans les cantines de la collectivité.
A plus grande échelle, la bio induit aussi une sorte de réciprocité intéressante entre le rural producteur de matières naturelles (eau, alimentation) et l’urbain ou le péri-urbain, sauf que là le rural tire son épingle du jeu et garde la valeur ajoutée de sa production. C’est cette réciprocité qui intéresse les citoyens, ils n’ont pas envie de se promener dans une campagne « musée » ou « substrat » de productions intensives qui désertifient nos territoires.
Enfin, manger bio c’est avaler peu voire pas de pesticides, donc avoir une meilleure santé, comme l’indiquent régulièrement des études scientifiques. Il faudrait d’ailleurs un jour étudier l’impact d’une alimentation saine, bio et moins carnée, sur les coûts évités pour une collectivité.

Dans la future nouvelle réglementation bio européenne, il pourrait y avoir de nouvelles règles pour les agriculteurs. En particulier, ils devront respecter des limites maximales de résidus dans leurs aliments. Une bonne nouvelle ?
Pas vraiment. Aujourd’hui, être en bio c’est se passer des produits chimiques de synthèse, ce qui est une obligation de moyens, dûment contrôlés sur nos fermes. Or, ce que veut la Commission européenne, c’est une obligation de résultats.
Mais on ne maitrise pas toujours les pollutions résiduelles qui proviennent des voisins, d’un problème de stockage ou de transformation ! Par ailleurs, les aliments sont régulièrement analysés en aval, notamment par la distribution.
Dans un monde rêvé, oui, nous pourrions être soumis à une obligation de résultat sur la moindre trace… si l’on était indemnisés en cas de déclassement pour des raisons non intentionnelles. C’est la position que défend José Bové au Parlement européen. En réalité, nous constatons une opposition farouche des conventionnels à l’idée d’une prise en charge financière de leur part, en cas de pollution de leurs voisins bio.
En gros, les pollueurs ne sont toujours pas les payeurs.
Oui, et dans l’attente de cet idéal, nous préférons conserver le système actuel, où le producteur a une obligation de moyens. En parallèle, on avance avec les autorités des Etats membres sur l’harmonisation des systèmes de contrôle et la gestion des coexistences de culture bio et non bio, où il y a beaucoup à faire.
Dans l’ensemble, cette future réglementation soulève des enjeux cruciaux. Pas facile de débattre à 27 d’une norme publique, extrêmement technique, qui devra s’appliquer à des contextes agricoles et pédo-climatiques très différents ! Par exemple, les pays les plus au sud, dont la France, refusent l’autorisation des serres chauffées demandées par quelques producteurs des pays nordiques. Non pas pour les empêcher de produire des légumes, mais pour éviter qu’un contexte très spécifique ne remette en cause les fondamentaux de la bio – produire sur un sol vivant – et au regard de l’impact environnemental.
Nous sommes engagés depuis plus de 2 ans dans ce processus. L’objectif du commissaire d’alors, Dacian Ciolos, était de renforcer la cohérence des pratiques bio, pour qu’elles répondent aux exigences des consommateurs, plus nombreux et plus exigeants.
Pensez-vous que le label européen mériterait d’être plus exigeant, notamment sur les critères sociaux, la taille des fermes ou le respect animal lors de l’abattage ?
C’est vrai, le principal reproche que nous faisons au cahier des charges européen est de ne pas avoir inclus davantage de critères sociaux.
Mais je le rappelle, le texte européen est dans une phase de négociation entre la Commission européenne, qui dispose d’un contingent d’experts, le Parlement européen, qui a fait un important travail de débat, et le Conseil européen où la France essaie de faire entendre sa voix sur les grands principes de fond (lien au sol, obligation de moyens, etc.). Il y aura encore de nouvelles étapes jusqu’au résultat final, mais ce texte sera un compromis, une base légale avec lequel il faudra travailler. Y compris pour développer ou améliorer des marques complémentaires – comme le label Bio Cohérence en France, pour faire valoir des pratiques nationales et/ou spécifiques.
La bio est une démarche de progrès permanente, nous continuerons d’avancer dans ce sens au plus près des consommateurs qui sont avant tout des citoyens désireux de comprendre ce projet, fait avant tout de valeurs, mais aussi de techniques et de normes.
Beaucoup de sceptiques pensent encore que les aliments bio sont de toute façon contaminés par la pollution environnante. Que répondez-vous à cela ?
Ils n’ont qu’à voir les résultats des analyses produits régulièrement par la presse consumériste ou par l’association Générations futures. Les conclusions sont claires, il y a beaucoup plus de résidus de pesticides dans les aliments conventionnels. Il y aura toujours des sceptiques, comme des « soutiens critiques » qui disent en consommer ou s’y intéresser mais qui passent leur temps à dénigrer la bio, au motif qu’elle devrait être parée de toutes les vertus (sociales, environnementales etc.). Nous ne sommes pas des magiciens, seulement des agricultrices et agriculteurs en démarche de progrès permamente.
Nous avons des exigences importantes et souhaitons toujours mieux faire ; on invite d’ailleurs les citoyens à s’associer à notre mouvement pour en débattre.

En bio on est censé réduire les coûts d’achat d’intrants chimiques. Comment se fait-il qu’au final, les produits bio soient plus chers à l’achat ?
Ce sujet du prix juste mérite en effet d’être débattu. En conventionnel, les agriculteurs sont dépendants à la fois des intrants qu’on leur vend et des acheteurs, qui profitent d’une situation quasi oligopolistique pour négocier à la baisse les matières premières. Tout le monde le sait, en conventionnel c’est l’agriculteur qui sort perdant du jeu de la valeur ajoutée.
En bio, nous revendiquons le contraire, avec la notion du prix juste. Ce prix tient compte des coûts de production en bio (peu ou pas d’intrants mais plus de main-d’œuvre) et du revenu décent du producteur au sein d’un système marchand équilibré (entre le transformateur et le distributeur). Il se justifie d’autant plus auprès du consommateur qu’il est associé à une production de qualité, et non à du tout-venant industriel. Sans oublier que le consommateur y gagne aussi, en co-finançant ainsi des externalités positives qui profitent à tous (dépollution de l’eau, de l’air et des sols).
Que pouvons-nous attendre de la politique européenne pour qu’elle soutienne l’agriculture biologique ?
La prise en compte dans la PAC des services écologiques rendus par l’agriculture biologique changerait beaucoup de choses. La bio serait mieux rémunérée, compte tenu de son système de production; à l’inverse, la logique de l’agriculture industrielle, avec l’agrandissement des fermes, serait pénalisée.
Il est clair que la PAC de 2020 devra se justifier au regard des attentes sociétales, car ce sont bien les citoyens qui la financent. Ils sont donc en droit d’attendre que cette politique travaille pour l’intérêt général, pour contribuer au respect de l’environnement et de la santé, à la redynamisation des territoires ruraux, au soutien de la paysannerie en Europe etc. C’est un débat citoyen, clairement politique, qui ne se limite pas aux intérêts corporatistes du monde agricole.
Peut-on imaginer un jour que les produits bio coûtent en moyenne le même prix que les produits conventionnels, afin que les consommateurs aient le sentiment que la bio est pour tous ?
On ne peut pas raisonner comme cela. L’horizon de la bio n’est pas sa « conventionnalisation », c’est-à-dire de prendre comme référence le prix des produits conventionnels aujourd’hui. Tous les jours, depuis des années maintenant, il y a des manifestations agricoles contre cette logique déflationniste dans laquelle on a mis les producteurs : toujours plus et toujours moins cher. Non seulement les agriculteurs sont en crise économique mais en plus la collectivité paye cette crise par des subventions et autres plans d’urgence permanents…
Mais comment, alors, peut-on rendre la bio plus accessible ?
Nous travaillons le sujet de l’accessibilité de différentes manières. D’abord sur une offre bio et locale, qui permet aux consommateurs d’être au plus proche des fermes et de gagner en prix sur les produits de saison. Ensuite, il faut améliorer – avec les distributeurs spécialisés et généralistes – la chaine d’approvisionnement en amont. Ca, c’est un grand chantier, une question d’organisation entre amont et aval qui est centrale aujourd’hui, qui doit nous permettre de gagner en compétitivité prix sans remettre en cause le « juste prix » payé au producteur.
Enfin, il nous faut promouvoir des circuits de proximité à dimension sociale, comme avec la restauration collective (cantines, restaurants d’entreprises etc.) ou des démarches d’économie sociale et solidaire (paniers solidaires etc.).
Le prix des produits conventionnels n’intègre pas les coûts de dépollution ou de santé dus à l’utilisation de pesticides. Peut-on envisager que cela change ?
Pas tant que les gouvernements raisonneront en terme de « sécurité alimentaire », c’est-à-dire de garantie de grands volumes à bas prix. Par ailleurs, les lobbys agro-alimentaires dépensent des fortunes pour remettre en cause ce type d’initiative. Cela a été le cas récemment à Bruxelles, pour empêcher l’étiquetage tricolore qui aurait permis au consommateur d’identifier les produits à risques pour sa santé.
Vous êtes aussi éleveuse de vaches laitières. Avez-vous toujours été en bio ?
Mon père était paysan dans les Vosges et j’ai toujours souhaité faire ce métier. Quand il est passé en bio en 1991, j’ai suivi attentivement sa démarche et ça m’a convaincue que c’était la seule voie à suivre pour assurer mon avenir en agriculture : produire des aliments de grande qualité, en toute autonomie, en préservant le sol et les biens communs.
Je souhaitais également que mon mode de production et de vie n’impacte pas les paysans des autres pays, notamment ceux en développement. Je voulais leur laisser la possibilité de produire eux-mêmes leurs aliments, sans les inonder de nos produits subventionnés ni contribuer à leur paupérisation en achetant du soja sud-américain dont dépendent de nombreuses exploitations conventionnelles [Note : les immenses cultures OMG s’accompagnent de déforestation et de l’expulsion des petits paysans]. Je voulais donc qu’on produise nous-mêmes nos protéines végétales et vendre le plus localement possible.
Quand je me suis installée en agriculture en 1998, avec mon mari Guylain, nous avons tout de suite lancé la conversion de la ferme de mes beaux-parents et celle d’un voisin ! Nous avons été certifiés bio en 2000. Aujourd’hui nous sommes trois associés (mon mari, mon beau frère et moi) et avons cinq collaborateurs à temps partiel ou à temps plein. Nous élevons 60 vaches laitières avec 140 hectares de prairies et 20 hectares de cultures et transformons la moitié de notre production laitière en fromages au lait cru (tomme, f romages frais, fromage blanc, crème…)
Pour finir, faites-vous attention à l’impact de vos façons de consommer ?
Je mange bio, évidemment ! Et j’essaye de réduire ma consommation de viande. Mais je ne serai jamais végan, car je considère que l’animal a un rôle essentiel dans notre mode de production et nos vies.
J’essaye d’être attentive à l’origine des produits (alimentaires ou non) et à leurs conditions de production. Pas facile de trouver des chaussures, vêtements ou meubles qui soient produits localement et avec des principes écologiques…
Ce qui m’importe, c’est d’être dans une démarche de progrès, pour que mes actes d’achat soient toujours plus en cohérence avec les valeurs et idées que je défends.
—
 Stéphanie PAGEOT est productrice bio en Loire-Atlantique. Elle est présidente de la FNAB depuis avril 2013.
Stéphanie PAGEOT est productrice bio en Loire-Atlantique. Elle est présidente de la FNAB depuis avril 2013.Le site de la FNAB : www.fnab.org/