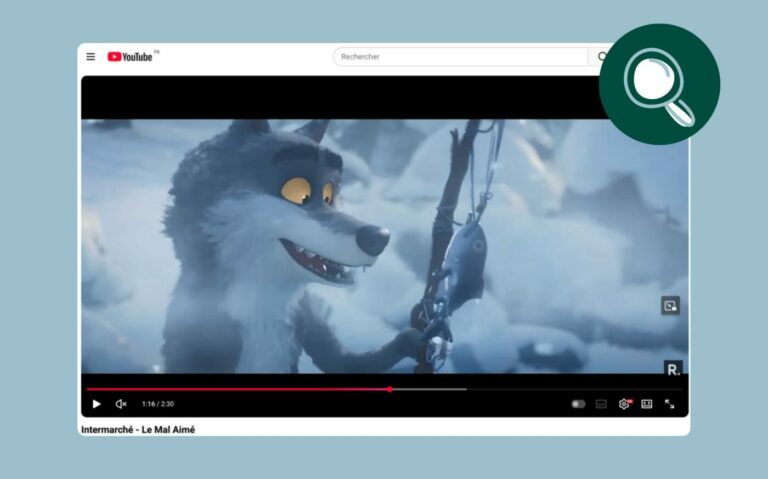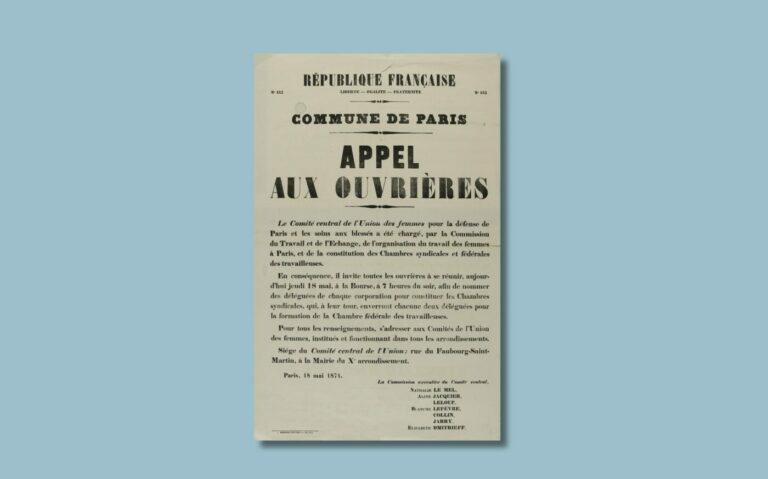Suite à la publication de Gilles-Eric Séralini sur les effets à long terme d’un OGM et d’un pesticide, l’agence française de sécurité sanitaire et le haut conseil des biotechnologies reconnaissent le manque de documentation sur ce sujet. Elles ne remettent pour autant pas en cause les évaluations réglementaires qui ont permis la mise en marché de ces produits.
Trois. C’est le nombre d’études qui se seraient intéressées aux effets sur la vie entière des organismes génétiquement modifiés (OGM), selon l’autorité nationale de sécurité sanitaire (Anses) et le haut conseil des biotechnologies (HCB), dans leurs avis rendus publics le 20 octobre 2012. Et trois, c’est en comptant l’étude de Gilles-Eric Séralini, publiée le 19 septembre dans la revue Food and chemical toxicology. Parmi les deux autres études, l’une n’était disponible qu’en japonais. On ne sait donc rien des effets sanitaires à long terme des OGM. La logique voudrait qu’on interdise toute utilisation de plantes transgéniques dans l’alimentation humaine et animale, tant que leur innocuité n’aura pas été démontrée. Principe de précaution oblige. Sauf que c’est trop tard : cela fait quinze ans que l’on nourrit nos animaux d’élevage avec des plantes génétiquement modifiées – au moins en partie. Plus de la moitié des aliments fournis aux animaux d’élevage sont en effet importés. En grande majorité, ces importations proviennent d’Amérique du Sud et concernent du soja transgénique. On nourrit donc nos bêtes avec des aliments dont les effets à long terme sont «clairement insuffisamment documentés», avoue Marc Mortureux, directeur de l’Anses. Dommage.
Comme si elle ne savait pas que la plupart des autorisations d’OGM au niveau européen ont été données sur la base d’études à 90 jours, l’Anses réclame désormais plus d’études sur vie entière. «Il faut engager des travaux sur ces effets long terme, dans le cadre de financements publics, afin de crédibiliser le dispositif d’évaluation des OGM». Le problème, c’est que les moyens de la recherche publique sont plus limités que ceux de l’agro-industrie semencière (les Syngenta, Monsanto, BASF etc.). Sachant qu’une étude comme celle de Seralini, menée sur 200 rats durant 2 ans, a coûté 3 millions d’euros. Et qu’elle ne suffit pas, aux dires de l’agence sanitaire, pour «remettre en cause les précédentes évaluations». Elle a pourtant le mérite d’exister et de remettre le sujet de l’évaluation des OGM sur la table. Christian Vélot, généticien moléculaire, membre comme Séralini du Comité de recherche et d’information indépendante sur les OGM et du comité de soutien de Bio Consom’acteurs, réagit aux critiques des détracteurs de Séralini.
Les évaluations européennes des OGM pour mise sur le marché posent question. D’après l’organisation à but non lucratif TestBiotech, qui regroupe des experts sur les biotechnologies, l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ferait deux poids, deux mesures pour juger les études qui lui sont soumises. «L’EFSA a en de nombreuses occasions accepté des publications qui ne respectaient pas les standards scientifiques qu’elle cite aujourd’hui pour critiquer l’étude de Séralini. Les résultats de ces précédentes études n’avaient pas identifié de risque sanitaire et ont été adoptées sanscritique », constate l’organisation. Pis : une analyse par TestBiotech des différentes études lui fait affirmer que «les standards scientifiques utilisées dans l’étude de Séralini sont plus rigoureux que ceux utilisés dans les études précédentes».
Le gouvernement français souhaite de son côté «une remise à plat du dispositif européen d’évaluation, d’autorisation et de contrôle des OGM et des pesticides», a annoncé Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, le 22 octobre. Et cinq ex-ministres de l’écologie, de tous bords politiques, ont appelé à ce que «soient revues les études qui ont permis l’autorisation de mise sur le marché du NK603». Selon Ségolène Royal, Dominique Voynet et Corinne Lepage, initiatrices de l’appel, «le principe de précaution doit l’emporter sur la présomption de non-toxicité de ces produits».